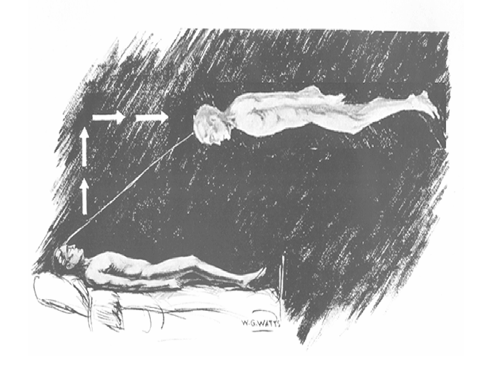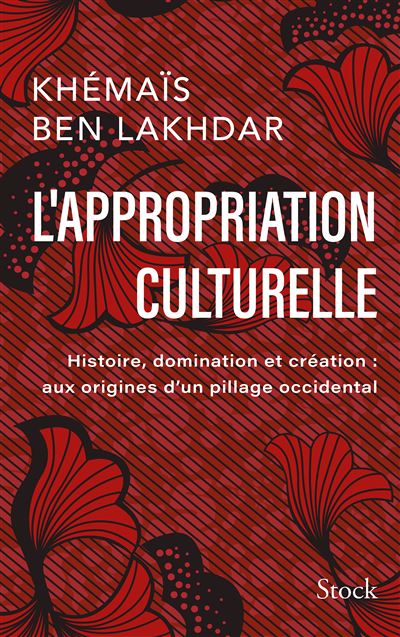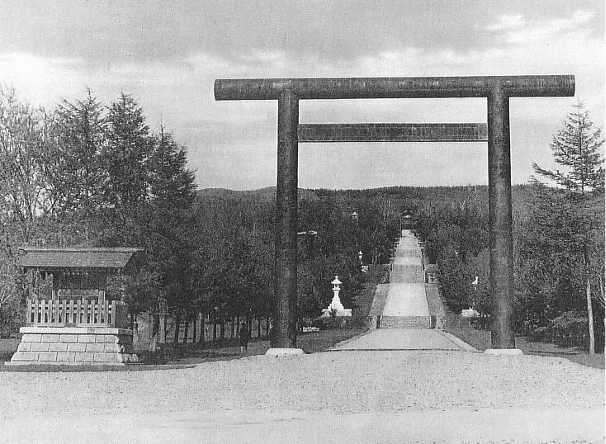Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Nida-Errahmen Ajmi, j’ai 29 ans et je suis née à Fribourg. En termes d’études, j’ai fait un Bachelor en ethnologie et science de l’information et communication, puis plus tard un master en société plurielle, culture, politique et religion. J’ai fait également un CAS intitulé « pratiquer l’aumônerie musulmane dans les institutions publiques » et c’est cette formation qui m’a permis ensuite de rejoindre l’aumônerie de l’armée. Actuellement, je travaille principalement à deux endroits : d’abord en tant que responsable de communication chez ATD Quart Monde qui est une ONG qui traite de la pauvreté en Suisse ; et je suis également coordinatrice du CAS que j’ai moi-même suivi sur l’accompagnement spirituel-aumônerie musulmane à l’Université de Fribourg. Je suis aussi illustratrice, je fais des BD et j’anime parfois des événements qui ont pour but de sensibiliser à certaines questions telles que le harcèlement de rue ou le racisme.
Tu as commencé l’armée en 2019, or l’aumônerie de l’armée n’a été accessible en Suisse pour les personnes de tradition musulmane qu’en 2021, qu’est-ce qui t’a poussé à rejoindre l’armée alors que tu faisais tout autre chose ? Y avait-il un lien avec ta foi ?
Parce que tout est lié, je peux difficilement dire quelle est la chose qui a fait que j’ai rejoint l’armée. C’était un tout.
Ma foi a joué sur la vision du monde que j’ai héritée de ma famille et de mes cultures. J’avais envie de servir et d’apporter à ce pays à mon tour. Bien que je ne pense plus comme ça aujourd’hui, j’avais le sentiment que si je voulais l’égalité de droits entre les hommes et les femmes, il fallait aussi une égalité de devoirs. J’ai aussi été attirée par le côté discipline que l’on retrouve à l’armée et la camaraderie. C’était une expérience presque absurde car personne dans ma famille ne l’a faite et qu’il y a très peu de femmes : ce n’était pas un endroit pour moi mais j’ai eu envie d’essayer.
Comment en es-tu venue alors à vouloir devenir aumônière de l’armée ?
J’ai découvert l’aumônerie avec l’armée. Au départ, j’étais soldat du train et j’ai rencontré des besoins assez spécifiques car je suis une femme romande, urbaine et musulmane. Dans cette école de recrue, il y avait une majorité d’hommes suisses allemands issus de la campagne et plutôt chrétiens. J’ai rencontré là-bas mon lieutenant qui est une femme tessinoise et qui a pu accueillir ce que je vivais et qui était invisible pour la plupart des autres. Cela m’a fait me rendre compte à quel point un seul profil pouvait avoir un impact positif sur autrui. En effet, elle savait ce que je vivais, y avait fait face et avait pu le dépasser. Elle m’a dit qu’en tant que femme, j’attirais l’attention deux fois plus, alors il faudrait que j’en fasse deux fois plus également pour trouver ma place. Une fois ce chemin parcouru, je me suis sentie apte à accueillir à mon tour les expériences multiples des autres. C’est de cette façon et grâce à ma passion du spirituel au sens large que je pourrais le mieux servir.
Quel est ton rôle en tant qu’aumônière ?
Quand on est aumônier·ère·x, on est responsable de l’accompagnement spirituel, éthique, religieux et moral des militaire·x·s peu importe leur grade ou leur religion. Personnellement, j’envisage le spirituel comme le « faire-sens » de quelqu’un·e·x., autrement dit quelque chose qui est en nous et qui nous dépasse, nous permettant d’envisager la réalité qui nous entoure. Ce qu’on peut considérer comme éthique, spirituel et religieux diffère d’une personne à l’autre, même si elles sont de même confession.
Lorsqu’on va à l’armée, on s’arrache de nos ressources habituelles et les moments difficiles traversés nous demandent de redéfinir notre identité et nos habitudes. Nous, les aumônier·ère·x·s, aidons les militaires à remobiliser leurs ressources, leur spiritualité, et redonner du sens à leurs croyances afin de s’ancrer un peu plus dans l’armée.
Généralement, on m’appelle souvent pour des entretiens, pour poser des questions sur les rituels religieux (ramadan, prière, messes, etc.). On peut aussi leur rendre visite à l’improviste, même quand tout semble aller bien et sans déranger leur activité. Comme le dit Noel Pedreira – ancien remplaçant du chef de l’aumônerie de l’armée – « Nous ne sommes pas seulement des pompiers qui venons pour éteindre le feu ». L’idée est aussi de prévenir le feu.
Tu as mentionné juste avant que tu t’occupais aussi des questions concernant la messe, tu réponds donc aux demandes de tout le monde, sans distinction de confessions ?
Oui, chaque aumônier·ère·x accompagne tou·x·te·s les militaires, peu importe leur foi. Nous avons un réseau d’aumônier·ère·x·s en interne, donc nous avons la possibilité de nous questionner entre nous pour pallier aux différents besoins. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle l’aumônerie s’est diversifiée. La Suisse se pluralise, alors la demande évolue. La majorité des citoyen·ne·x·s se déclarent d’ailleurs comme sans appartenance religieuse ou croient en quelque chose de non confessionnel ; notre travail est d’aider chacun·e·x à mobiliser ses propres ressources.
Par ailleurs, cette collaboration entre aumônier·ère·x·s de diverses confessions (chrétienne, juive, musulmane) est propre à l’armée. La majorité des autres aumôneries ont des aumônier·ère·x·s chrétien·ne·x·s pour tout le monde et les non-chrétien·ne·x·s par confessions. Cela est dû au contexte historique et structurel de la Suisse, car à l’origine l’Eglise prenait soin de la population et de l’ordre. Chez nous, on dit de manière un peu rigolote « aumônier qui est musulman » pour montrer qu’on est tous engagés à titre égal.
Tu as dit au journal « La Liberté » que tu as dû te battre pour devenir aumônière de tradition musulmane. Peux-tu m’en dire plus sur la formation que tu as faite ainsi que sur les défis personnels que tu as dû relever ?
Le premier aumônier musulman a rejoint l’armée en 2022. J’y étais alors depuis 3 ans en tant que soldat du train. Avant que cette possibilité ne s’ouvre, j’ai rejoint l’aumônerie en tant que stagiaire universitaire dans le cadre de mon master pour m’en approcher car cela me passionnait. Lorsque c’est devenu possible, il fallait une formation civile, alors j’ai aussi fait le CAS sur l’accompagnement spirituel.
Depuis 2021, tout dans ma vie (armée, travail, études) est dédié à cette passion que j’ai pour l’aumônerie.
De plus, à cela s’est ajouté l’aspect médiatique, car je suis la première femme à être à cette place et cela attise l’intérêt. Ce n’est pas quelque chose que j’ai cherché, j’ai juste suivi mon chemin. Cette exposition est un poids que je ne considère ni facile, ni difficile, mais quelque chose avec lequel je vis à présent.
N’as-tu donc finalement pas été victime de racisme ou de discrimination ?
Oui, ça m’est aussi arrivé, mais beaucoup moins que ça a pu se produire hors de ce cadre. On retrouve du racisme et de la discrimination à l’armée comme on en retrouve dans notre société ; ce sont d’ailleurs ces dynamiques sociétales qui s’importent dans l’armée et qui s’adaptent à sa structure. Cependant, l’armée met en place des moyens pour nous protéger de cela et je n’ai jamais hésité à m’en servir chaque fois que j’en ai eu besoin.
Est-ce que tu dirais alors que l’armée se veut de plus en plus inclusive ?
Oui. Nous avons par exemple le chef de l’armée en fonction depuis 2020, Monsieur Thomas Süssli, qui a vraiment su apporter cette cohésion et cette paix actuelle dans l’armée suisse et à qui je porte beaucoup de respect pour son engagement. Nous appliquons la tolérance zéro en matière de discrimination. Même s’il y a des failles comme dans chaque système, les règles et les structures sont mises en place pour combattre cela.
Est-ce que tu dirais que ton profil atypique a plutôt été un frein ou un levier pour qu’on vienne se confier à toi en tant qu’aumônière ?
Cela dépend. Certaines personnes se sont senties plus en confiance avec moi. Le fait que je puisse représenter plusieurs minorités a probablement aidé certain·e·x·s à se sentir à l’aise, je pense notamment aux personnes homosexuelles qui ne parlaient de cette thématique qu’avec moi. Il a été plus difficile de tisser du lien avec certain·e·x·s à cause de la barrière de la langue. Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai pu ressentir un écart avec des personnes de ma division car c’était en majorité des hommes suisses allemands. Si j’avais été affectée dans la division dans laquelle je me trouve aujourd’hui, mon expérience aurait été tout à fait différente. En effet, dans celle-ci il y a une majorité de francophones issu·e·x·s de la diversité. L’armée est en réalité très multiculturelle.
En plus d’être une femme musulmane au sein de l’armée, tu es aussi une femme voilée. Quel rapport entretient l’armée en tant qu’institution avec le fait que tu portes le voile et qu’ainsi tu te démarques des autres ?
Dans le règlement, nous avons le droit, si le commandant le permet, de porter quelque chose qui n’a pas été fourni par l’armée. Mon voile est donc autorisé car il est très discret et ressemble aux couvre-chefs de l’armée utilisés pour se protéger du froid. Tant que le service est priorisé et que personne n’est mis en danger, nous pouvons porter des signes extérieurs.
Et pour toi ? Quel sens donnes-tu à cela ? Porter le voile te donne-t-il une autre approche pour conscientiser la symbolique des autres tenues militaires que tu portes ?
Pour être honnête : non.
Premièrement pour moi, ce voile doit rester dans le détail car ce n’est pas un trait d’identité ou une valeur à part entière. Je donne beaucoup plus de sens à mon insigne de l’aumônerie qu’à ce que j’ai sur la tête. Par ailleurs, ce choix de me couvrir est quand même pour moi très important car je lie cela à ma féminité et à ma modestie au sens spirituel, mais il n’est pas pour moi forcément chargé de symbole à l’armée. Je m’explique : je pense qu’en Suisse, on donne trop d’importance aux vêtements féminins. Pour le cas de mon voile, ce n’est qu’un bout de tissu auquel moi je donne du sens en fonction de ma croyance et de ma foi. Autrement dit, il est important pour ce qu’il représente pour moi mais pas au niveau de l’armée.
Comment concilies-tu ta foi avec le fait de faire partie de l’armée qui d’apparence peut sembler à contre-sens des convictions religieuses ?
Je dirais que la réponse est dans la phrase : d’apparence seulement. Pour moi et grâce à ma foi, il est très important de vivre de manière éthique. En tant que citoyenne suisse, je bénéficie de cette société et ainsi de certains privilèges de sécurité, confort, etc. J’ai alors envie de m’engager dans cette société qui m’offre tout ça, car si tout le monde ne fait que prendre sans rien donner, ce pays redeviendra pauvre comme il l’était il y a quelques centaines d’années.
Je me voyais bien m’investir dans la sécurité. Nous sommes dans un pays considéré comme militairement neutre, l’utilité de cette institution qu’est l’armée est alors principalement de prendre soin de la population dans le cas d’une crise au sein du pays. Ma foi me pousse à me responsabiliser et me donne envie de ne pas seulement profiter des avantages de la Suisse, mais aussi de donner de moi. Il y a un verset du Coran (282. La sourate Al-Baqarah) qui dit « Un peuple ne change pas tant qu’il ne se change pas par lui-même ». En gros, si j’espère quelque chose pour la Suisse, je dois l’incarner en tout premier. De plus, le fait de se dévouer et de servir fait aussi partie de ma personnalité.
Tu milites beaucoup au travers des réseaux sociaux, de ton art, etc. Perçois-tu une forme de militantisme dans l’activité d’aumônière ?
Non pas du tout, c’est pour moi juste de l’accompagnement spirituel. En revanche, pour que je puisse accéder à cette place, beaucoup se sont battus. Avec la pluralisation de la Suisse, il y a eu un besoin qui s’est créé de voir de la diversité chez les aumônier·e·x·s.
Même si l’aumônerie n’est pas un acte militant, mon engagement dans ma vie est d’être juste, intègre et authentique et on m’a qualifié de militante lorsque je suivais simplement ces valeurs. On peut alors se demander où commence et où s’arrête le militantisme. Je me considère comme quelqu’un plus engagé que militant.
J’ai vu que tu luttais contre le colonialisme, je me demandais si et comment tu articules une pensée et un engagement décolonial avec ton engagement à l’aumônerie en tant que musulmane ?
En réalité, je ne l’ai pas pensé tel quel. C’était à nouveau pour moi des valeurs d’ouverture et de dévotion héritées de ma foi, mais aussi un concours de circonstance à la lumière du parcours évoqué. Mes pensées sur la colonisation sont venues plus récemment grâce à mes études dans les sciences sociales, qui m’ont fait développer une pensée beaucoup plus analytique et scientifique. Ce n’est que très récemment que j’ai commencé à voir les choses sous ce prisme-là, notamment par rapport à ma propre histoire. Je m’explique : la raison pour laquelle je suis en Suisse est directement liée au colonialisme. Il y a eu tellement de ravages dans mon pays d’origine, la Tunisie, à cause de la colonisation française, que mes parents sont venus en Suisse pour y faire des enfants dans un cadre plus serein et par désir d’y retrouver la liberté de croire qui n’était pas garantie en Tunisie. C’est aussi un message que je porte aujourd’hui.
Comment vois-tu l’avenir du métier d’aumônier musulman ?
C’est une question que l’on se pose actuellement au Centre Suisse Islam et Société (CSIS). Avec la demande actuelle en Suisse, des postes s’ouvrent petit à petit dans diverses institutions, ce qui montre que l’on tend vers une stabilisation et une professionnalisation de cette activité. Mais c’est une tendance, pas une certitude.
Que peut-on te souhaiter ?
Je me souhaite de l’apaisement et du bonheur. Etant une femme très engagée, je tends vers un peu plus de sérénité.
Image : Nida-Errahmen Ajmi.