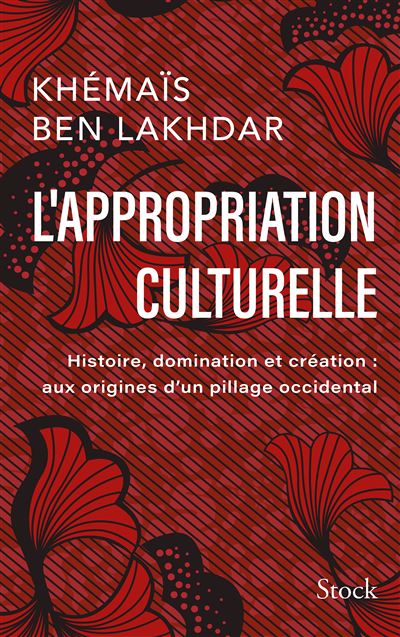
15.04.2025
Appropriation culturelle : comprendre au-delà des polémiques
Certaines notions nous paraissent à la fois familières et insaisissables, comme un mot étranger dont on saisit le sens sans pouvoir le traduire précisément. C'est le cas de l’appropriation culturelle. Bien que ce concept nous soit familier, le définir clairement ou l'appliquer à des situations concrètes reste complexe.
Quels sont ses critères ? Peut-on porter un kimono ? Pourquoi une personne blanche avec des dreadlocks suscite-t-elle la controverse ? L’usage de mots arabes par des locuteur·rice·x·s sans lien avec cette langue peut-il être perçu comme offensant ? La réponse n’est ni totalement affirmative ni totalement négative, et l'incertitude demeure.
Les médias ne simplifient pas le débat, bien au contraire. Plutôt que de proposer une définition claire qu’iels appliqueraient à des exemples concrets, les journalistes – qui souvent aussi perdu·e·x·s que nous – spéculent, s’indignent et polémiquent. Le célèbre « On ne peut plus rien dire ! », souvent repris par des personnes conservatrices préoccupées par les débats sociétaux, reste omniprésent. Le chercheur Kémais Ben Lakhdar, auteur de L’appropriation culturelle. Histoire, domination et création : aux origines d’un pillage occidental, souligne qu’en France, « Autour de ce sujet brûlant, le débat est devenu impossible. Certains se lamentent : on ne peut même plus s’habiller comme on le souhaite, tandis que d’autres militeraient pour une vigilance extrême quant à l’origine du moindre accessoire[1] ». En Suisse, l’appropriation culturelle est moins médiatisée mais suscite tout de même des débats. En 2022, un concert à Berne est annulé après que des spectateur·rice·x·s se sont offusqué·e·x·s de la coiffure des membres du groupe – tous blancs –, arborant des dreadlocks. La Brasserie Lorraine, organisatrice de l'événement, décide alors d’interrompre la performance, déclenchant une vague d’indignation en ligne. En 2023, une photo du repas de soutien du Parti libéral-radical de la Gruyère fait scandale. À l’occasion d’un menu à base de fondue chinoise, les convives se griment en caricatures asiatiques, selon le thème de la soirée. La Jeunesse socialiste fribourgeoise dénonce un acte raciste et une forme de yellowface : « Nous condamnons cette appropriation culturelle du PLR gruérien. C’est un manque flagrant de respect envers la communauté asiatique. Une culture n’est pas un déguisement[2]. » Dans l’article du Blick couvrant cette affaire, Stéphane Baechler, président du PLR de La Gruyère, rejette ces accusations, les attribuant à des manœuvres politiques en période électorale. Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, soutient cependant la critique de la JS, tout en reconnaissant l’absence d’intention malveillante[3].
Dans son livre, Khémaïs Ben Lakhdar rappelle que l’appropriation culturelle s’inscrit dans des rapports de domination. Elle se produit lorsqu’un groupe dominant s’approprie des éléments culturels d’un groupe minoritaire sans respecter ni reconnaître leur contexte historique et socioculturel. Contrairement à un simple échange culturel, elle repose sur une relation inégalitaire, souvent liée à l’histoire coloniale et à l’exploitation commerciale.
Ainsi, lorsque Dior lance une collection inspirée des motifs berbères sans créditer les artisan·e·x·s, ou que la haute couture puise dans les traditions vestimentaires africaines sans en reconnaître les origines, il s’agit bien d’appropriation culturelle. Ces pratiques relèvent de ce que Ben Lakhdar nomme le cannibalisme culturel : une industrie qui, sous des logiques capitalistes, s’empare du patrimoine culturel sans contrepartie ni considération pour les communautés concernées.
Toutefois, tout emprunt culturel n’est pas nécessairement abusif. La différence entre un échange légitime et une appropriation problématique repose sur l’intention et ses conséquences. Par exemple, une personne non japonaise portant un kimono dans un cadre respectueux, en reconnaissant son origine et son histoire, ne pose pas forcément problème. En revanche, une caricature ou une mise en scène stéréotypée à des fins de divertissement relève d’une autre dynamique. Dans les cas suisses mentionnés, il est essentiel de distinguer appropriation culturelle et racisme. L’annulation du concert à Berne questionne la perception des symboles culturels et la légitimité ou non de certain·e·x·s à se les réapproprier.[4] Quant aux déguisements du PLR gruérien, ils relèvent davantage d’un racisme ordinaire, dénué de réflexion sur l’histoire et ses implications. Comme l’affirme bell hooks, « Dans la culture marchande, l’ethnicité devient une épice, un assaisonnement qui relève la fadeur de la culture dominante[5]. » Les accoutrements dont se sont affublé les convives n’existent que dans l’imaginaire occidental, et démontrent un grand manque de connaissance vis-à-vis des cultures asiatiques.
Pour aller plus loin, le livre de Khémais Ben Lakhdar offre une réflexion approfondie et nuancée sur ce sujet important. L’auteur nous encourage à nous poser les bonnes questions et à soutenir les échanges entre les cultures sans ignorer les mécanismes de domination qui les sous-tendent. Comprendre l’appropriation culturelle, c’est reconnaître qu’aucun acte culturel n’est neutre. Vêtements, coiffures, arts et traditions s’inscrivent dans un contexte historique très souvent lié à des rapports de pouvoir. Plutôt que d’imposer des interdictions ou de se refermer sur des identités figées, il faut encourager un dialogue sincère et respectueux. Comme le suggère le sociologue Éric Fassin, chaque cas doit être analysé en concertation avec les communautés concernées pour déterminer s’il s’agit d’un enrichissement mutuel ou d’une exploitation abusive[6]. Bien sûr, un tel sujet ne peut être parfaitement résumé ou même intelligible à travers ces quelques paragraphes. C’est pourquoi, la lecture de l’ouvrage de Khémais Ben Lakhdar est une clé vers une compréhension plus fine du concept de l’appropriation culturelle et de ses implications dans notre société.
Image : Première de couverture du livre de Khémais Ben Lakhdar, L'appropriation culturelle. Histoire, domination et création : aux origines d'un pillage occidental, Stock, 2024.
[1] Khémaïs Ben Lakhdar, L’appropriation culturelle. Histoire, domination et création : aux origines d’un pillage occidental, 2023
[2] https://www.20min.ch/fr/story/la-soiree-chinese-face-du-plr-gruerien-passe-mal-472255760081
[3] https://www.blick.ch/fr/suisse/comportement-raciste-le-comite-du-plr-gruerien-se-deguise-en-asiatique-et-fait-polemique-id18448057.html
[4] https://www.watson.ch/fr/societe/analyse/700983931-tout-comprendre-de-l-appropriation-culturelle
[5] bell hooks, Eating the Other: Desire and Resistance, 1992
[6] https://www.rts.ch/info/monde/13341510-podcast-cest-quoi-exactement-lappropriation-culturelle.html